
21 mars 2025
Bulletin interne de l'Institut Pasteur


Retour sur la journée du 7 mars - Excellence Scientifique : et si l’inclusion était la clé ?
À l’occasion de la Journée internationale des droits des femmes, la direction de la diversité, de l’équité et de l’intégration (DEI) de l’Institut Pasteur et la Fondation L'Oréal ont conjointement organisé le symposium “ Excellence scientifique : et si l’inclusion était la clé ? ” le vendredi 7 mars. Retrouvez ci-après quelques extraits de l’événement et l’intégralité de l’événement ici (avec sous titres français et anglais).
L’événement rappelait que la lutte pour la préservation de l’excellence scientifique, notamment sur la question de la représentation des genres, est de la responsabilité de toutes et tous. Particulièrement dans le contexte international actuel où la science est particulièrement challengée, se faisant ainsi l’écho de la marche Stand-Up for Science qui avait lieu le même jour.

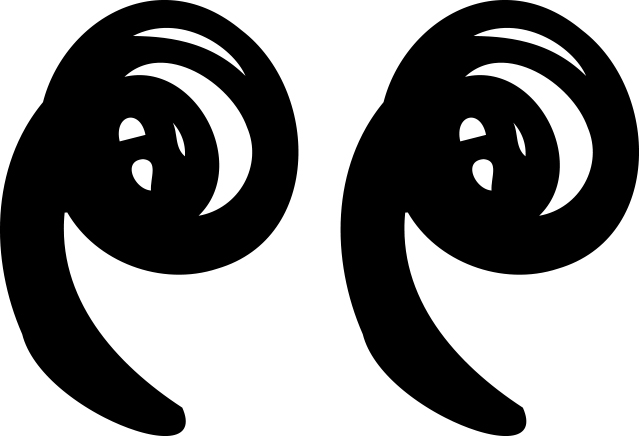 En cette Journée internationale des droits des femmes, joignons notre combat à ceux de la science, aujourd’hui confrontée à des défis sans précédent : des données supprimées, gel de budget, licenciements… mais aussi des thèmes qui se trouvent interdits comme « femme », « équité », « inégalité » (…) Rappelons que la lutte pour une science libre et indépendante est aussi une lutte pour la démocratie. Défendre la science, c'est défendre nos valeurs les plus fondamentales. C'est un engagement pour l'excellence.
En cette Journée internationale des droits des femmes, joignons notre combat à ceux de la science, aujourd’hui confrontée à des défis sans précédent : des données supprimées, gel de budget, licenciements… mais aussi des thèmes qui se trouvent interdits comme « femme », « équité », « inégalité » (…) Rappelons que la lutte pour une science libre et indépendante est aussi une lutte pour la démocratie. Défendre la science, c'est défendre nos valeurs les plus fondamentales. C'est un engagement pour l'excellence.

Mariana Mesel-Lemoine
Directrice chargée de la diversité, de l’équité et de l’inclusion

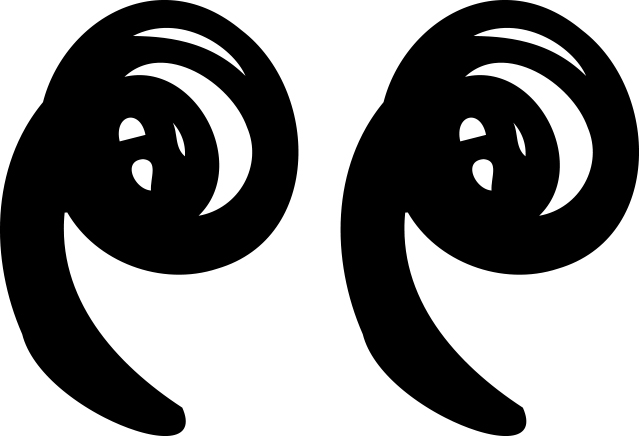 Cette collaboration avec l'Institut Pasteur, pour nous à la Fondation L'Oréal, est très symbolique et importante parce que cela montre qu'on est ensemble, qu'on partage cette conviction que la diversité et que l'inclusion, ce ne sont pas juste des valeurs morales. Elles sont absolument essentielles pour le progrès et pour l'excellence scientifique. Je pense qu'on a toutes et tous, une responsabilité individuelle à continuer, à ne pas lâcher.
Cette collaboration avec l'Institut Pasteur, pour nous à la Fondation L'Oréal, est très symbolique et importante parce que cela montre qu'on est ensemble, qu'on partage cette conviction que la diversité et que l'inclusion, ce ne sont pas juste des valeurs morales. Elles sont absolument essentielles pour le progrès et pour l'excellence scientifique. Je pense qu'on a toutes et tous, une responsabilité individuelle à continuer, à ne pas lâcher.

Pauline Avenel-Lam
Directrice exécutive de la Fondation L’Oréal

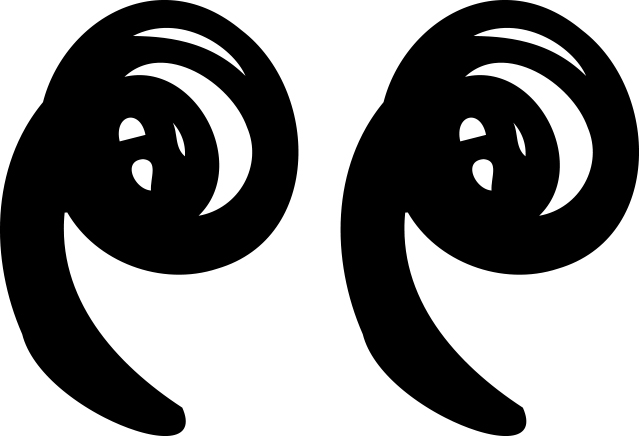 Valoriser chaque talent et chaque parcours sans laisser personne de côté, s'assurer que les résultats de la recherche soient applicables et accessibles à toutes et à tous. La tolérance zéro comme seul seuil acceptable pour une institution qui aspire à l'excellence. (…) La sécurité comme un impératif pour la science, pour l'excellence. Au-delà des observations, voir les choses différemment pour passer à l'action.
Valoriser chaque talent et chaque parcours sans laisser personne de côté, s'assurer que les résultats de la recherche soient applicables et accessibles à toutes et à tous. La tolérance zéro comme seul seuil acceptable pour une institution qui aspire à l'excellence. (…) La sécurité comme un impératif pour la science, pour l'excellence. Au-delà des observations, voir les choses différemment pour passer à l'action.

Myriam Hayatou
Directrice du programme Pour les Femmes
et La Science de la Fondation L’Oréal
 Femme de sciences pour l’excellence scientifique
Femme de sciences pour l’excellence scientifique
Cette session de regards croisés a abordé l’importance du rôle modèle d’exemple féminin dans les sciences. L’occasion de souligner les synergies permises par la sororité dans les réseaux de femmes, permettant de dépasser les biais de genre, que ce soit dans les comités de sélection ou la perception de la maternité.

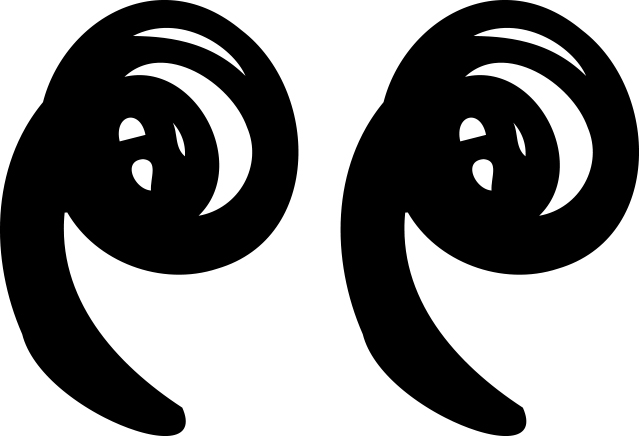 Une autre rencontre, au cours d’une fête de la science, avec Claudie Haigneré, qui était à l'époque ministre de la Recherche. Elle m'avait interpellée et m’a demandé ce que je voulais faire plus tard. Je ne savais pas très bien quoi répondre alors à cette question, et elle m’a dit « Mais il faut faire de la recherche ! ». Elle semblait tellement décomplexée et ça semblait tellement normal pour elle de me dire ça. Je crois que j’ai conscientisé à ce moment-là que peut-être c’était ça que je souhaitais faire, que c’était possible pour moi. (…) La sororité et l'alliance entre-nous, nous permettent de collectivement faire une science plus inclusive.
Une autre rencontre, au cours d’une fête de la science, avec Claudie Haigneré, qui était à l'époque ministre de la Recherche. Elle m'avait interpellée et m’a demandé ce que je voulais faire plus tard. Je ne savais pas très bien quoi répondre alors à cette question, et elle m’a dit « Mais il faut faire de la recherche ! ». Elle semblait tellement décomplexée et ça semblait tellement normal pour elle de me dire ça. Je crois que j’ai conscientisé à ce moment-là que peut-être c’était ça que je souhaitais faire, que c’était possible pour moi. (…) La sororité et l'alliance entre-nous, nous permettent de collectivement faire une science plus inclusive.

Audrey Desgrange
CR Inserm, Institut Imagine et Institut Pasteur

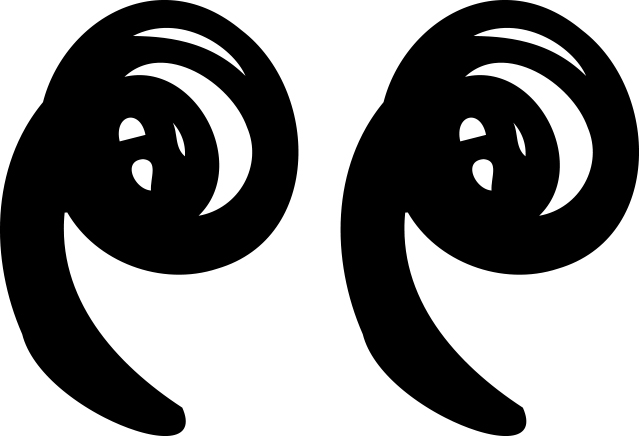 Le défi principal c'est de se dire que même si c'est un milieu où je ne suis peut-être pas 100 % à l'aise tout le temps, où je ne m'identifie pas forcément à ceux qui sont là… je vais faire l'effort de rester. Pour donner l'exemple, pour celles qui nous suivent et pour changer ça de l'intérieur. Pour moi, c'était la chose la plus difficile.
Le défi principal c'est de se dire que même si c'est un milieu où je ne suis peut-être pas 100 % à l'aise tout le temps, où je ne m'identifie pas forcément à ceux qui sont là… je vais faire l'effort de rester. Pour donner l'exemple, pour celles qui nous suivent et pour changer ça de l'intérieur. Pour moi, c'était la chose la plus difficile.

Sarah Merkling
Directrice de laboratoire à l’Institut Pasteur

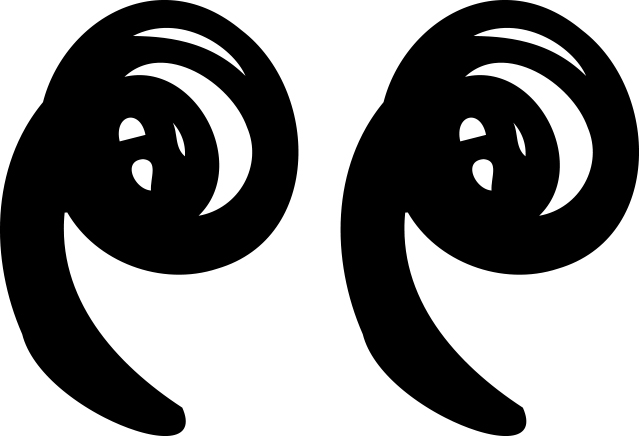 Il ne faut pas essayer de suivre les définitions de quelqu'un d'autre. Il faut, poursuivre nos propres parcours, toujours avec cette quête d'excellence. Mais il faut définir l'excellence pour soi-même. Je souhaite à toutes les femmes et les hommes scientifiques autour de cette terre beaucoup de courage parce qu'il nous en faut.
Il ne faut pas essayer de suivre les définitions de quelqu'un d'autre. Il faut, poursuivre nos propres parcours, toujours avec cette quête d'excellence. Mais il faut définir l'excellence pour soi-même. Je souhaite à toutes les femmes et les hommes scientifiques autour de cette terre beaucoup de courage parce qu'il nous en faut.

Michelle Rathman
Directrice de la prospection scientifique, l’Oréal
 Analyse de données de l’Observatoire des VSS dans l'enseignement supérieur
Analyse de données de l’Observatoire des VSS dans l'enseignement supérieur
Retour sur l’enquête menée sur le territoire national auprès de plus de 1 700 doctorants en 2024. Ce travail met en lumière, chiffres et verbatims à l’appui, l’état des lieux sur la question des violences sexistes et sexuelles (VSS) dans le milieu académique.

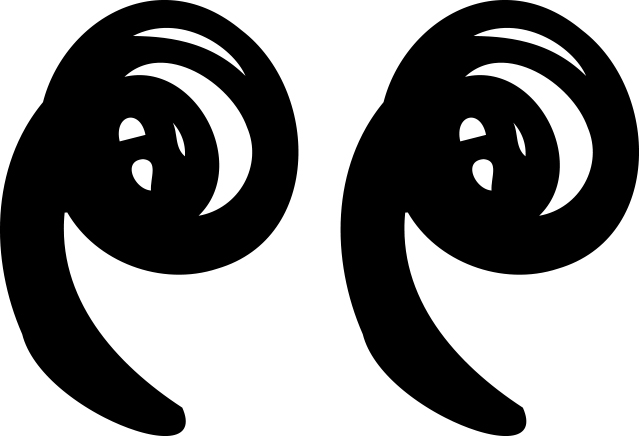 51,7 % des répondants estiment qu'aujourd'hui, en France, le doctorat est un cadre propice au VSS.
51,7 % des répondants estiment qu'aujourd'hui, en France, le doctorat est un cadre propice au VSS.
Pour plus de détails, cela correspond à 56 % des femmes, 70 % des personnes non-binaires et 43 % des hommes.

Marion Elie
Responsable du pôle Analyse de Données
Observatoire des VSS dans l'enseignement supérieur

Extrait et adaptation de l’étude Pressions, silence et résistances : étude sur les violences sexistes et sexuelles et les discriminations en milieu doctoral en France. Présentation par Marion Elie, Observatoire des violences sexistes et sexuelles dans l’enseignement supérieur.
Effectif : 1 710 doctorant(e)s en 2024
Répartition de l’effectif : 61,2 % de femmes, 34,4 % d’hommes, 3 % de personnes non-binaires)
 La science en quête d’inclusion : Pourquoi cela résiste ?
La science en quête d’inclusion : Pourquoi cela résiste ?
Cette table ronde a questionné les éléments de contexte favorisant le maintien des VSS dans l’environnement professionnel, notamment académique.

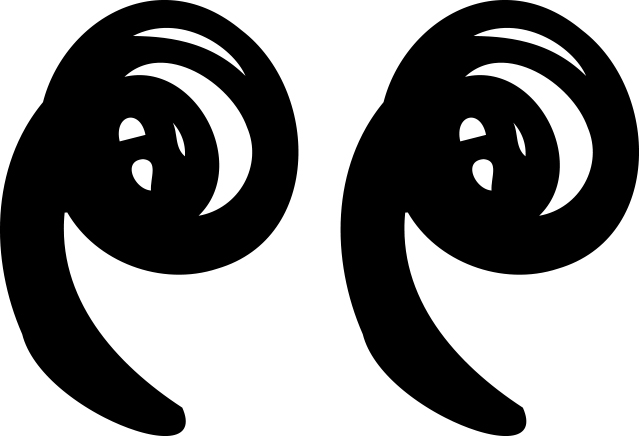 Le premier frein pour rendre l'action possible, c’est quand on a le collectif qui dit : « Non, mais chez nous ce n’est pas pareil. On sait qu'il y a des violences, mais nous quand même, on est tel labo, c'est l'université ici, ce n’est quand même pas pareil, on est des gens sérieux quoi. » (…) Cela m'a toujours un peu gênée parce que j'ai toujours l'impression parfois qu’on se réfugie un peu derrière ça pour ne pas agir.
Le premier frein pour rendre l'action possible, c’est quand on a le collectif qui dit : « Non, mais chez nous ce n’est pas pareil. On sait qu'il y a des violences, mais nous quand même, on est tel labo, c'est l'université ici, ce n’est quand même pas pareil, on est des gens sérieux quoi. » (…) Cela m'a toujours un peu gênée parce que j'ai toujours l'impression parfois qu’on se réfugie un peu derrière ça pour ne pas agir.

Caroline De Haas
Co-fondatrice et directrice associée du groupe Egaé

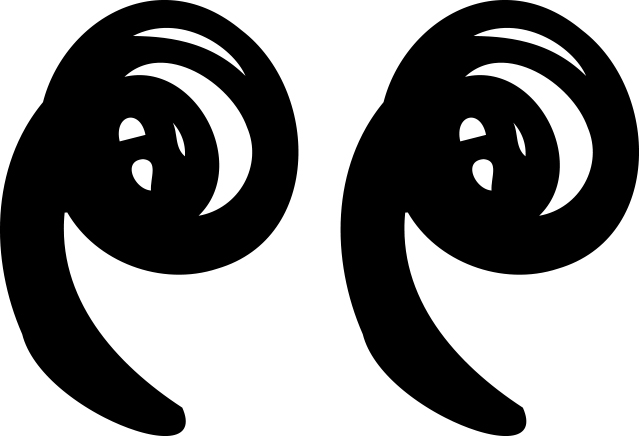 Il y a cette culture de se complaire dans l’idée que pour prouver que l’on mérite d’être là, pour prouver qu'on a beaucoup travaillé, on peut mettre sa santé en danger, parce qu’on évolue dans un endroit hyper prestigieux. Finalement, on est habitué à voir des gens au bout du rouleau, fatigués, se faisant crier dessus ou recevant une petite blague graveleuse… tout ceci devient la normalité (..) il y a aussi le fait que la recherche est un vase-clos, fonctionnant beaucoup sur recommandation, l’évaluation ne se fait qu’entre pairs… le moindre « petit caillou » peut impacter une publication, la carrière, l’accès au diplôme du doctorat etc…
Il y a cette culture de se complaire dans l’idée que pour prouver que l’on mérite d’être là, pour prouver qu'on a beaucoup travaillé, on peut mettre sa santé en danger, parce qu’on évolue dans un endroit hyper prestigieux. Finalement, on est habitué à voir des gens au bout du rouleau, fatigués, se faisant crier dessus ou recevant une petite blague graveleuse… tout ceci devient la normalité (..) il y a aussi le fait que la recherche est un vase-clos, fonctionnant beaucoup sur recommandation, l’évaluation ne se fait qu’entre pairs… le moindre « petit caillou » peut impacter une publication, la carrière, l’accès au diplôme du doctorat etc…

Adèle B. Combes
Autrice de l’essai « Comment les universités broient les jeunes chercheurs »
(éd. Autrement)
Les intervenants et intervenantes ont aussi évoqué des solutions, notamment en rappelant l’obligation légale du Code du travail imposant à l’employeur de prévenir, faire cesser et sanctionner les violences sexistes et sexuelles. Il a aussi été démontré comment aborder ces questions favorise une rétention efficace des talents, moteur essentiel pour l’innovation, la pérennité et détermine l’image des entreprises.

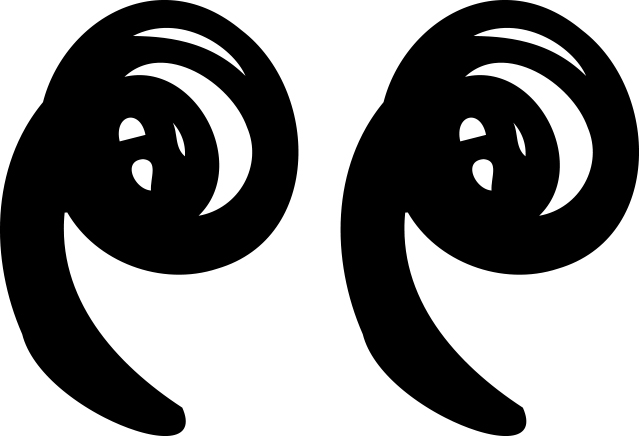 En travaillant sur le respect de la parité et de la parole - des femmes et des personnes dont le Français n’est pas la langue maternelle - nous avons amélioré la qualité d'écoute de l'ensemble des collaborateurs et des collaboratrices de la boîte. Le bien-être de chacun nous a permis d’avoir une forte résilience et une forte solidarité, nous menant à de vrais succès, malgré les hauts et les bas propres aux startups. Ce qui est intéressant c’est que le monde des startups est un véritable laboratoire d’innovations sociales dont on peut s’inspirer !
En travaillant sur le respect de la parité et de la parole - des femmes et des personnes dont le Français n’est pas la langue maternelle - nous avons amélioré la qualité d'écoute de l'ensemble des collaborateurs et des collaboratrices de la boîte. Le bien-être de chacun nous a permis d’avoir une forte résilience et une forte solidarité, nous menant à de vrais succès, malgré les hauts et les bas propres aux startups. Ce qui est intéressant c’est que le monde des startups est un véritable laboratoire d’innovations sociales dont on peut s’inspirer !

Sébastien Garcin
CEO chez YZR
 Est-ce que les changements sont si difficiles ?
Est-ce que les changements sont si difficiles ?
Albert Moukheiber a remis en question l’idée reçue selon laquelle nous serions naturellement réfractaires au changement, la qualifiant de « psychologie intuitive » ou « psychologie de comptoir ». Ce séminaire a également abordé comment le cerveau reconstruit nos perceptions en fonction de nos expériences passées, de ce que chaque individu internalise… jusqu’à ce que, malgré le fait qu’une information soit connue, cela ne suffise pas toujours à nous en convaincre pour autant.

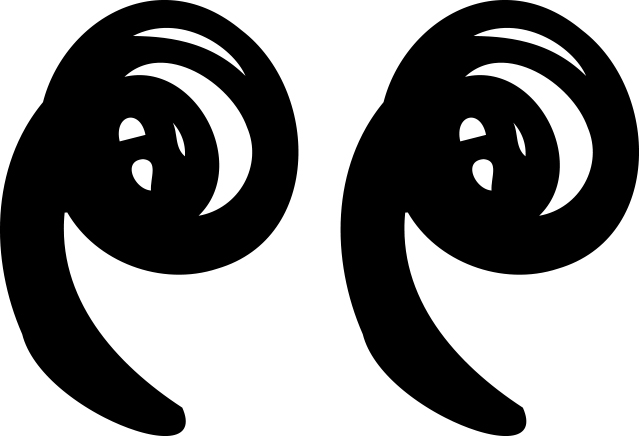 Rendre une personne moins sexiste ou moins raciste ou moins discriminante ? Ce n'est pas si difficile que ça. Vraiment. Ce qui est plus difficile, c'est comment est-ce qu'on change la représentation automatique des choses. (…) C'est ce contrôle méta cognitif qui ne peut pas être juste du fait de l'individu, c’est trop coûteux. Dans la lutte contre les discriminations, savoir et éduquer ne suffit pas : il est nécessaire de systématiser, de changer ce qui est acceptable. Serait-il imaginable aujourd’hui de ne pas systématiser les sanctions sur l’alcool au volant ?
Rendre une personne moins sexiste ou moins raciste ou moins discriminante ? Ce n'est pas si difficile que ça. Vraiment. Ce qui est plus difficile, c'est comment est-ce qu'on change la représentation automatique des choses. (…) C'est ce contrôle méta cognitif qui ne peut pas être juste du fait de l'individu, c’est trop coûteux. Dans la lutte contre les discriminations, savoir et éduquer ne suffit pas : il est nécessaire de systématiser, de changer ce qui est acceptable. Serait-il imaginable aujourd’hui de ne pas systématiser les sanctions sur l’alcool au volant ?

Albert Moukheiber
Psychologue clinicien et co-fondateur
de Chiasma, spécialiste des biais inconscients
 L’événement a également accueilli la pianiste internationale Juliana Steinbach, ouvrant le propos au domaine de la musique. L’artiste a fait découvrir à l’audience l’univers des compositrices, notamment brésiliennes, dont le talent de composition, de pédagogie et d’innovation, bien que connus de leurs cercles proches, a souvent été invisibilisé au bénéfice de leurs homologues masculins : parents, frères ou encore maris…
L’événement a également accueilli la pianiste internationale Juliana Steinbach, ouvrant le propos au domaine de la musique. L’artiste a fait découvrir à l’audience l’univers des compositrices, notamment brésiliennes, dont le talent de composition, de pédagogie et d’innovation, bien que connus de leurs cercles proches, a souvent été invisibilisé au bénéfice de leurs homologues masculins : parents, frères ou encore maris…
Voir ou revoir le symposium
Photos: François Gardy/Institut Pasteur

