
04 avril 2025
Bulletin interne de l'Institut Pasteur


Journée mondiale de l’autisme : trois questions à Thomas Bourgeron
C’est le 31 mars 2003 qu’une équipe internationale animée par les psychiatres Pr Christopher Gillberg et Pr Marion Leboyer, et le généticien Pr Thomas Bourgeron, découvre pour la première fois des mutations génétiques impliquées dans l’autisme. Une nouvelle ère s’ouvre alors, pour la communauté médicale, la communauté scientifique et pour les familles.
Plus de 20 ans après cette découverte, les chercheurs, mobilisés au sein de consortiums internationaux, misent aujourd’hui sur les études à grande échelle et la recherche participative pour élucider les mécanismes complexes impliqués dans l’autisme, qui mêlent facteurs génétiques et environnementaux, et progresser vers un accompagnement personnalisé.
Pour sensibiliser le grand public autour du spectre autistique et promouvoir l’inclusion des personnes autistes dans la société, l'Organisation des nations unies a instauré en 2007 la journée mondiale de l'autisme, célébrée chaque année le 2 avril et incarnée par la couleur bleue.
À cette occasion, BIP vous propose de lire le portrait de Thomas Bourgeron en trois questions et de découvrir la façade illuminée du bâtiment Emile Duclaux pour symboliser le soutien de l’Institut Pasteur.
 Trois questions à Thomas Bourgeron, responsable de l’unité Génétique humaine et fonctions cognitives, impliqué dans la découverte des premiers gènes associés à l’autisme et engagé sur ce volet depuis de nombreuses années :
Trois questions à Thomas Bourgeron, responsable de l’unité Génétique humaine et fonctions cognitives, impliqué dans la découverte des premiers gènes associés à l’autisme et engagé sur ce volet depuis de nombreuses années :
1- Pourriez-vous vous présenter pour les Pasteuriens et Pasteuriennes qui ne vous connaitraient pas ?
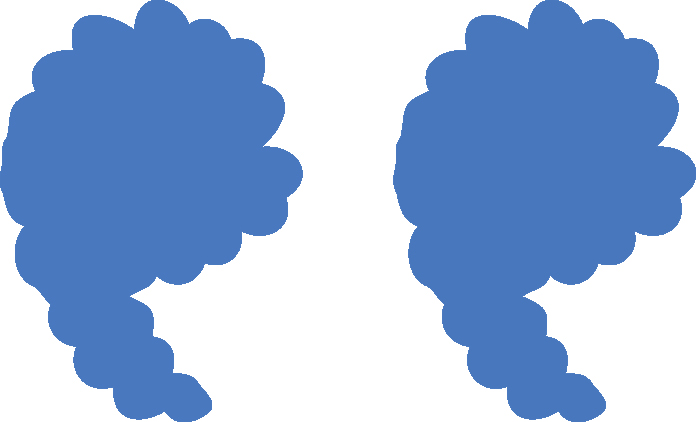 J’ai commencé par les échecs, puis la musique, avant de me tourner vers la biologie végétale. À l’époque, en tant qu’enzymologiste, chaque semaine j’épluchais quatre kilos de pommes de terre pour isoler la succinate déshydrogénase des mitochondries… de pommes de terre !
J’ai commencé par les échecs, puis la musique, avant de me tourner vers la biologie végétale. À l’époque, en tant qu’enzymologiste, chaque semaine j’épluchais quatre kilos de pommes de terre pour isoler la succinate déshydrogénase des mitochondries… de pommes de terre !
J’ai ensuite réalisé ma thèse sur les maladies mitochondriales sous la direction de Pierre Rustin et Agnès Rötig, au sein du laboratoire d’Arnold Munnich. Peu à peu, je suis devenu généticien, en identifiant les premières mutations nucléaires affectant le cycle de Krebs et la chaîne respiratoire chez l’homme. Ces mutations entraînaient de graves maladies neurologiques chez les nouveau-nés.
Par la suite, j’ai obtenu un poste de Maître de Conférences et rejoint le laboratoire de Marc Fellous à l’Institut Pasteur, où j’ai travaillé sur le déterminisme du sexe et l’infertilité masculine avec Ken McElreavey. En identifiant un nouveau gène, dans une région associée aux troubles psychiatriques, mon intérêt s’est porté sur l’autisme*, et en 2003, j’ai identifié les premiers gènes impliqués dans cette condition. À cette époque, nous étions trois au labo : Hélène Quach (technicienne), Stéphane Jamain (doctorant) et moi-même. Nous collaborions étroitement avec les psychiatres Marion Leboyer en France et Christopher Gillberg en Suède.
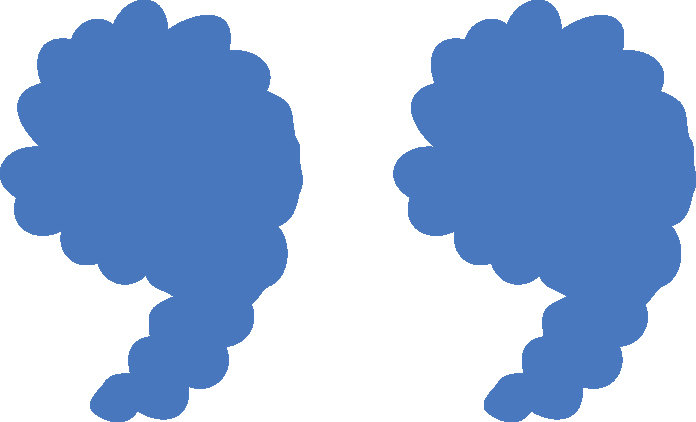
2- Pourriez-vous nous expliquer comment vos recherches vous ont porté hors les murs de votre laboratoire ?
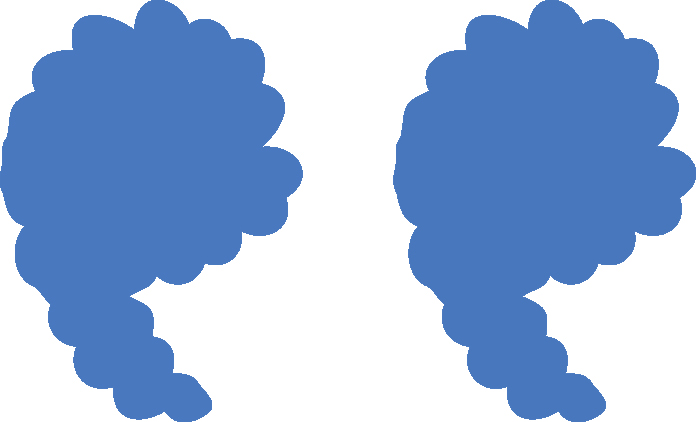 L’identification des premiers gènes associés à l’autisme a marqué une avancée majeure à plusieurs niveaux. Tout d’abord, elle a contribué à déculpabiliser les parents, longtemps considérés comme responsables de l’autisme de leur enfant. En particulier, les mères étaient accusées d’être froides et de rejeter leur bébé.
L’identification des premiers gènes associés à l’autisme a marqué une avancée majeure à plusieurs niveaux. Tout d’abord, elle a contribué à déculpabiliser les parents, longtemps considérés comme responsables de l’autisme de leur enfant. En particulier, les mères étaient accusées d’être froides et de rejeter leur bébé.
Ensuite, cette avancée a bouleversé la conception selon laquelle l’autisme était exclusivement une condition multigénique. En effet, dans les cas que nous avons identifiés, une seule variation génétique – parmi plus de trois milliards de lettres du génome ! – suffisait à provoquer d’importantes difficultés dans le développement cognitif, les interactions sociales et le langage.
Enfin, ces gènes codent pour des protéines essentielles au fonctionnement des synapses, ces points de contact entre les neurones. Cette découverte a ouvert la voie à l’identification de nombreux autres gènes impliqués, à une meilleure compréhension des mécanismes sous-jacents et au développement d’essais cliniques ciblés pour les patients en grande difficulté.
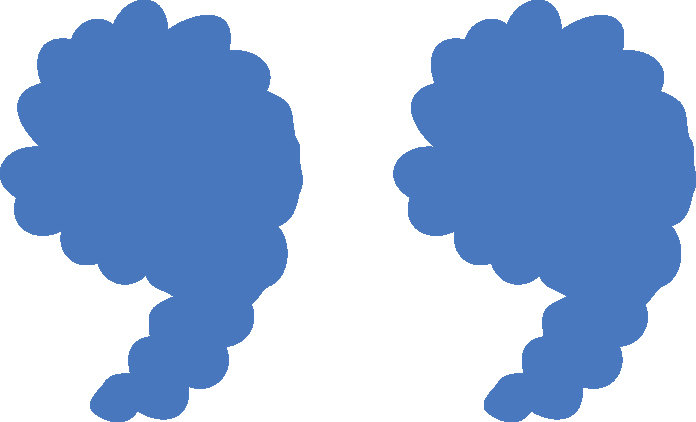
3- Quelles actions, avec quelles associations êtes-vous en contact et comment la journée du 2 avril vous permet de donner toujours plus de visibilité envers le public et les acteurs publics ?
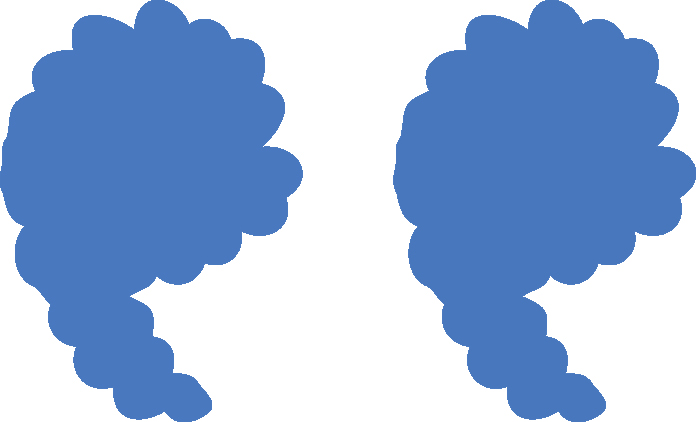 La génétique est la science de la diversité, et notre équipe s’engage à la fois dans l’amélioration du parcours de soin des personnes autistes – du diagnostic aux essais cliniques – et dans la reconnaissance de la neurodiversité. Puisque nous ne sommes pas tous neurotypiques, notre société doit mieux accueillir les personnes atypiques, que ce soit à l’école, au travail ou dans tous les aspects de la vie quotidienne.
La génétique est la science de la diversité, et notre équipe s’engage à la fois dans l’amélioration du parcours de soin des personnes autistes – du diagnostic aux essais cliniques – et dans la reconnaissance de la neurodiversité. Puisque nous ne sommes pas tous neurotypiques, notre société doit mieux accueillir les personnes atypiques, que ce soit à l’école, au travail ou dans tous les aspects de la vie quotidienne.
Cela implique de réduire la stigmatisation que les personnes autistes et leurs familles subissent au quotidien, mais aussi d’adapter les aides en fonction des besoins et des souhaits de chacun. Notre objectif est que chaque personne, y compris celles présentant des vulnérabilités, puisse s’autoreprésenter et s’épanouir pleinement. C’est un défi réalisable, à condition que nous y travaillions collectivement.
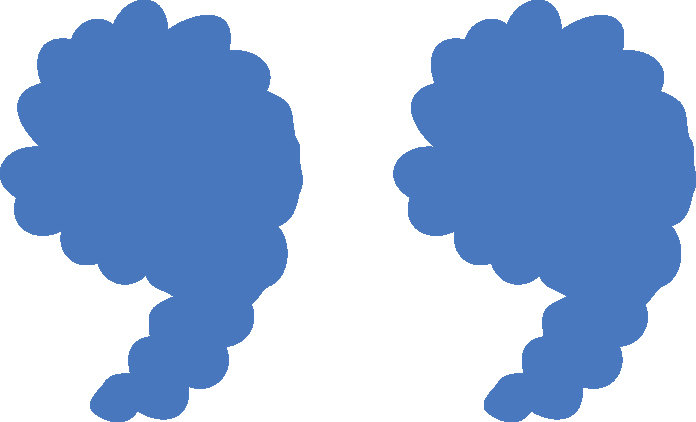
*Très récemment Thomas Bourgeron s’est vu récompensé du prix Jean Valade pour l’ensemble de sa carrière et ses travaux sur le développement du cerveau de l’enfant ainsi que pour son projet sur l’autisme : « CONTEXT pour promouvoir la recherche participative sur la génétique des troubles du neurodéveloppement et la neurodiversité ».
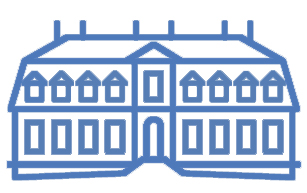 Afficher la couleur pour continuer à unir chercheurs, cliniciens, patients, familles et associations
Afficher la couleur pour continuer à unir chercheurs, cliniciens, patients, familles et associations
Choisie pour sa connotation douce et apaisante, la couleur bleue avait été initialement utilisée pour une opération de sensibilisation menée par l’association américaine Autism speaks. Depuis, le bleu est utilisé comme symbole de la journée mondiale de sensibilisation à l’autisme mais il est également accompagné de plusieurs autres teintes secondaires telles que le rouge et le vert.
Pour afficher son soutien, l’Institut Pasteur a ainsi illuminé en bleu la façade du bâtiment historique Émile Duclaux dans les nuits des 1er et 2 avril derniers, une marque identitaire forte visible pour l’ensemble des passants et conducteurs de la rue du Docteur Roux.
Merci aux services techniques et au service sûreté de l’Institut Pasteur pour leur appui dans le déploiement de ce dispositif.
