
25 juillet 2025
Bulletin interne de l'Institut Pasteur

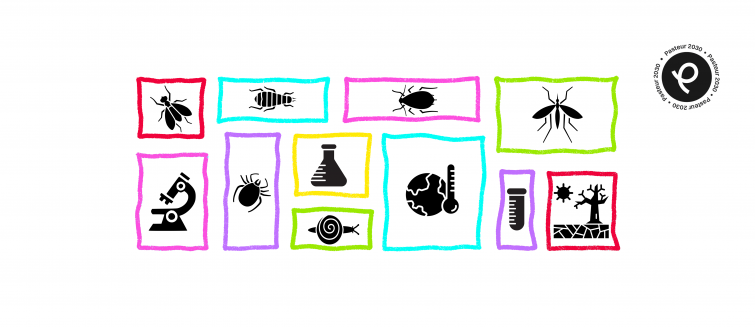
CMTV : Découvrez une équipe engagée et qui vous donne rendez-vous le 12 septembre prochain pour vous présenter l’offre de services à venir au sein de l’infrastructure

Le plan stratégique Pasteur 2030 souhaite renforcer le positionnement d’excellence de l’Institut Pasteur en matière de connaissances, de compréhension et de contrôle des infections émergentes, en particulier celles transmises par des vecteurs.
Pour accroitre son impact, et celui de la France, dans ce domaine, l’Institut Pasteur a débuté, en 2023, la construction d’un futur centre de recherche de très haut niveau scientifique et technologique. En rendant possible la réalisation de projets de recherche ambitieux, cette infrastructure contribuera à renforcer le positionnement de l’Institut Pasteur en tant que référence mondiale dans le domaine.
Le premier coup de pioche a été donné en mars 2024 pour la refonte complète des bâtiments historiques, Darré et Borrel. La livraison opérationnelle de la nouvelle infrastructure est prévue d’ici à trois ans, soit à la mi-mai 2028.
Accessible à l'ensemble du campus, cette infrastructure sera dotée de capacités technologiques de pointe avec, en particulier, des laboratoires spécifiques pour étudier les pathogènes les plus critiques dans des conditions optimales de sécurité, ainsi que les technologies d’imagerie de pointe désormais indispensables pour ce type de recherches.
Développé dans le respect des nouvelles normes environnementales, ce futur centre offrira des espaces pour faciliter la collaboration intra- et inter-bâtiments, la transdisciplinarité tout autant que la formation de jeunes chercheurs, et sera l’illustration de la force des alliances multidisciplinaires.
Il s’agit d’un projet phare de la priorité 2 du plan stratégique Pasteur 2030 (lire l'article du BIP du 13 juin), qui bénéficiera de surcroît très étroitement aux travaux de la priorité scientifique 1.
 Coup de projecteur, à la rentrée, sur l'offre de services des plateformes au sein du futur centre : rendez-vous le 12 septembre à 14h
Coup de projecteur, à la rentrée, sur l'offre de services des plateformes au sein du futur centre : rendez-vous le 12 septembre à 14h
Pour vous permettre d’en savoir plus sur les services qu’offriront les plateformes au sein de la future infrastructure, ainsi que sur l’avancée du chantier, l’équipe projet vous donne rendez-vous le 12 septembre prochain.
Intervenants :
• Introduction par Anna Kehres, directrice de projet d’infrastructure CMTV.
• Point sur les services proposés dans les espaces de production de vecteurs et d’infection expérimentale d’hôtes et de vecteurs par Sabine Thiberge, responsable du CEPIA, et Caroline Manet, ingénieure de recherche à l’animalerie centrale.
• Présentation des plateformes de bioimagerie en P3 par Nathalie Aulner, responsable de la plateforme technologique de bioimagerie photonique (PBI), et de Nanoimagerie en P3 par Matthijn Vos, responsable de la plateforme technologique de nanoimagerie (PNI)
• Point sur l’état d’avancement du chantier par Pascal Tenegal, responsable du service immobilier et technique
Pour suivre la réunion, cliquez sur ce lien : Rejoignez la réunion maintenant
 Coup de projecteur sur une équipe multidisciplinaire au service d’un projet d’envergure
Coup de projecteur sur une équipe multidisciplinaire au service d’un projet d’envergure
Retrouvez ici les témoignages des membres de l'équipe projet : regard croisé entre expertises, engagement et ambitions.
Anna Kehres, directrice de projet

1. Qu’est-ce qui vous motive le plus dans votre participation à ce projet ?
Ce qui me motive le plus dans ma participation à ce projet est l'opportunité de contribuer à la réalisation d'une initiative ambitieuse qui permettra à la communauté scientifique de mieux lutter contre les maladies infectieuses émergentes, notamment celles transmises par des vecteurs. Ce projet est un élément central de la priorité 2 du plan stratégique Pasteur 2030 portée par Anna-Bella Failloux, Philippe Bastin et Arnaud Fontanet, visant à renforcer le positionnement d'excellence de l'Institut Pasteur en matière de connaissances, de compréhension et de contrôle des infections émergentes. De plus, il soutiendra étroitement les efforts de la priorité 1 portée par Aude Bernheim et Olivier Schwarz.
Je suis également enthousiasmée par la perspective de participer à une entreprise collective, dont le succès reposera sur une grande diversité d'acteurs, de métiers et d'expériences, tant internes qu'externes à l'Institut Pasteur. Enfin, l'expertise, la créativité et l'engagement de l'équipe projet constituent pour moi une source d'inspiration et de motivation supplémentaires.
2. Comment votre expertise contribue-t-elle au succès de ce projet ? Quels sont les principaux défis concernant le CMTV pour votre direction ?
Ce projet transverse est constitué d’environ une dizaine de volets « métiers » interdépendants : immobilier, plateformes, finance, hygiène et sécurité, organisation et fonctionnement de l’infrastructure, RSE, ressources humaines, gestion de projet.
Mon rôle est de piloter sa réalisation et les risques associés ; d’animer l’équipe des chefs de projet métiers ; de dialoguer avec les parties intéressées et d’assurer une aide à la décision pour le comité de pilotage stratégique du projet. Mes précédentes expériences en gestion de projets transverses, en pilotage de chantiers d’organisation et ma connaissance de l’institut développée aux cours des 10 dernières années sont utiles.
Le principal défi est de concilier création de valeur durable pour les équipes scientifique et pour l’institut, respect des délais et respect du budget.
3. Si vous deviez décrire le projet CMTV en 3 mots ?
Stratégique, complexe, co-construit.
Animalerie centrale



Caroline Manet, François Rimlinger, Jean Jaubert
1. Qu’est-ce qui vous motive le plus dans votre participation à ce projet ?
Ce qui nous motive avant tout, c’est la science : contribuer à un projet ambitieux qui ouvrira de nouvelles perspectives de recherche pour les scientifiques de l’Institut Pasteur, en particulier sur des enjeux majeurs comme les maladies infectieuses et vectorielles.
Mais c’est aussi l’humain derrière la science : la possibilité de mener ce projet aux côtés d’une équipe compétente, engagée et multidisciplinaire, au service de l’ensemble de la communauté pasteurienne.
2. Comment votre expertise contribue-t-elle au succès de ce projet ? Quels sont les principaux défis concernant le CMTV pour votre direction ?
Notre équipe réunit des compétences variées et complémentaires, couvrant les dimensions scientifiques, techniques, réglementaires et opérationnelles liées à la gestion des animalerie expérimentales. Cette diversité d’expertises nous permet d’avoir une vision globale du projet et de concevoir une infrastructure à la fois rigoureuse, évolutive et au service de la recherche. Elle facilite l’anticipation des besoins, la maîtrise des contraintes réglementaires et techniques, et l’adaptation aux évolutions scientifiques.
Les principaux défis résident dans l’équilibre entre exigences scientifiques et contraintes propres au travail en confinement biologique de niveau 3, dans le respect strict du bien-être animal, ainsi que dans la mobilisation et la fidélisation d’équipes qualifiées, essentielles à la pérennité du CMTV.
3. Si vous deviez décrire le projet CMTV en 3 mots ?
Ambition scientifique, engagement collectif, infrastructures de pointe.
Équipe de la plateforme de bioimagerie photonique (PBI)



Christelle Travaille, Julien Fernandes, Nathalie Aulner
1. Qu’est-ce qui vous motive le plus dans votre participation à ce projet ?
Doter l'Institut Pasteur d'une plateforme d'imagerie optique pour analyser des pathogènes de risque 3, en adéquation avec les besoins réel des entités du campus.
2. Comment votre expertise contribue-t-elle au succès de ce projet ? Quels sont les principaux défis concernant le CMTV pour votre direction ?
Nos expériences combinées en termes de gestion de plateforme, d'étude de maladies infectieuses et vectorielles, d'imagerie optique et nos interactions étroites avec les utilisateurs nous semble être une force pour faire de ce projet une réussite.
Les principaux défis pour nous sont l'adéquation des technologies qui seront retenues avec les besoins réels du campus, l'aspect financier du projet et les ressources humaines nécessaires pour le mener à bien.
3. Si vous deviez décrire le projet CMTV en 3 mots ?
Mutualisation, innovation, challenge.
Équipe de la direction de la responsabilité sociétale de l’entreprise
et des ressources techniques (DRSE-RT)

Nathalie Denoyés
aux côtés de Patricia Sylvestre, Sylvie Chauvaux, Pauline Govindin, Léa Cheng, Jean-Sébastien Fournier
1. Qu’est-ce qui vous motive le plus dans votre participation à ce projet ?
Ce projet représente une formidable opportunité de contribuer à une démarche d’innovation technique et scientifique, avec des enjeux technologiques stimulants. Il se distingue également par sa dimension collaborative, fondée sur le travail en équipe et la mobilisation d’expertises multiples. L’attractivité scientifique du projet, tant sur le plan national qu’international, constitue pour nous une source de motivation supplémentaire.
2. Comment votre expertise contribue-t-elle au succès de ce projet ? Quels sont les principaux défis concernant le CMTV pour votre direction ?
Notre expertise en biosécurité, en décontamination et en pilotage de projets nous permet d’accompagner la conception d’un bâtiment pensé comme un véritable outil de recherche : modulable, durable, agile et sécurisé.
L’objectif est de créer un environnement qui facilite le travail conjoint des différentes expertises impliquées dans la recherche sur les maladies vectorielles. Notre connaissance fine du campus et des équipes scientifiques appelées à utiliser ce bâtiment constitue également un atout pour anticiper leurs besoins spécifiques.
Le principal défi du groupe de travail CryoEM est de garantir un haut niveau de sécurité tout en assurant un pilotage des équipements de haute technologie flexible et évolutif nécessaire à la recherche collaborative.
3. Si vous deviez décrire le projet CMTV en 3 mots ?
Innovation technologique, modernité, projet fédérateur.
Équipe du service immobilier et technique



Delphine Delonca, Pascal Tenegal, Hervé Ali-Mandjee
1. Qu’est-ce qui vous motive le plus dans votre participation à ce projet ?
Il est très motivant de faire partie de ce projet de grande ampleur qui fédère toutes les Directions de l’Institut Pasteur.
Pour le service immobilier et technique (SIT), la construction du CMTV rassemble de nombreuses prouesses techniques et organisationnelles.
C’est un bâtiment d’une très haute technicité, à intégrer dans un campus hyper contraint qui doit rester en fonctionnement, et avec une dimension environnementale ambitieuse.
2. Comment votre expertise contribue-t-elle au succès de ce projet ? Quels sont les principaux défis concernant le CMTV pour votre direction ?
La mise en commun de nos différentes expertises nous permet de relever plusieurs défis :
• Livrer un bâtiment qui fonctionne dès sa mise en service et répond aux besoins d’une science de haut niveau grâce notre expertise dans la conception technique, le maintien du dialogue avec les futurs occupants et la rigueur dans le suivi d’exécution
• Livrer une plateforme de cryo-EM en BSL3 qui reste un vrai challenge et s’appuie sur des expertises rares
• Faire collaborer, sur la longueur, une équipe complexe dans laquelle chacun a sa spécialité avec des méthodes de gestion de projet éprouvées pour respecter les coûts, les délais et la sécurité.
Nous sommes persuadés que les enjeux techniques ne peuvent être surmontés que si le collectif les affronte.
3. Si vous deviez décrire le projet CMTV en 3 mots ?
Collectif, prouesse technologique, ambitieux.
Équipe du centre de production et d’infection des anophèles (CEPIA)

Sabine Thiberge, Audrey Lorthiois
1. Qu’est-ce qui vous motive le plus dans votre participation à ce projet ?
Nous sommes motivées à l’idée de contribuer à un projet innovant qui donnera aux chercheurs la possibilité d’explorer les interactions entre hôtes, pathogènes et vecteurs dans une même infrastructure. Cet environnement sécurisé et stimulant sera une vraie chance pour faire avancer la recherche sur les maladies vectorielles.
2. Comment votre expertise contribue-t-elle au succès de ce projet ? Quels sont les principaux défis concernant le CMTV pour votre direction ?
L’expertise que nous avons développée au CEPIA, en accompagnant les projets sur le paludisme grâce à l’élevage d’anophèles et à la maîtrise de la culture du parasite, pourra servir de modèle pour la mise en place des plateformes du C2RA au CMTV, qui accueillera d’autres vecteurs et pathogènes. Le principal défi sera de réussir à coordonner efficacement tous les acteurs impliqués, afin que cette structure élargie soit pleinement efficace pour soutenir la recherche.
3. Si vous deviez décrire le projet CMTV en 3 mots ?
Innovant, intégré, dynamique.
Équipe de la plateforme technologique de nanoimagerie


Matthjin Vos, Jean-Marie Winter
1. Qu'est-ce qui vous motive le plus dans votre participation à ce projet ?
C’est surtout l’intégration du processus de microscopie cryo-corrélative à lumière et à électrons qui sera intégré dans un environnement BSL-3 : une première mondiale ! Bâtir une installation unique jetant les bases de découvertes majeures et permettant aux chercheurs d’observer les structures internes aux cellules avec une netteté et une résolution inédites, c'est un peu comme être les pionniers de l'exploration spatiale avec le télescope Hubble.
2. Comment votre expertise contribue-t-elle au succès de ce projet ? Quels sont les principaux défis concernant le CMTV pour votre direction ?
Avant de rejoindre l'Institut Pasteur il y a environ 7 ans, Jean-Marie et moi-même avons participé à la révolution de la résolution en cryo-microscopie électronique et nous avons tous les deux travaillé ensemble pendant plus de 35 ans, en tant qu'experts pour fabricant des microscopes. Nous collaborons à la mise en place de l’installation dédiée dans l’environnement BSL-3 et à l’élaboration des protocoles de décontamination pour ces machines complexes. Pour la partie cryo-EM, le principal défi consiste à trouver comment allier une technologie de microscopie extrêmement complexe et délicate à des règles de sécurité strictes qui n’ont jamais prévu son utilisation dans un environnement BSL-3.
3. Si vous deviez décrire le projet CMTV en 3 mots ?
Pionnier, novateur, ambitieux.